Colloque de 2025
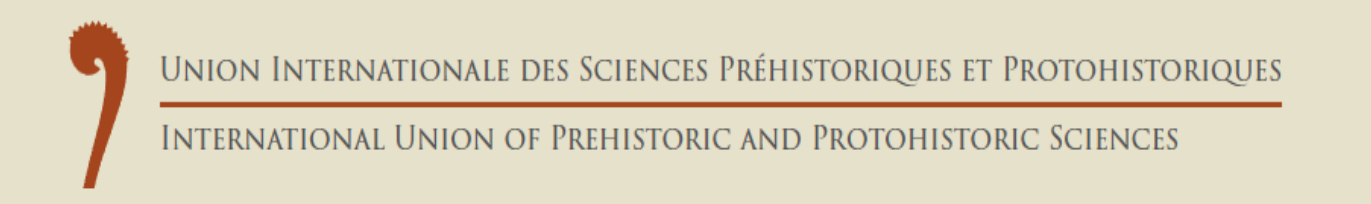
Colloque inter-Congrès du 10 octobre 2025
Institut de Paléontologie Humaine
Fondation Prince Albert 1er de Monaco
1 rue René Panhard, 75013 Paris
Organisation
Djillali Hadjouis
Commission UISPP Méthodes et théorie archéologiques
Annonce du colloque sur le site de l'UISPP

9h-9h15 : Accueil
9h15-9h30 : Présentation de la commission Méthodes et théorie en archéologie UISPP et de la Journée Historiographie et épistémologie des chercheurs du MNHN
Djillali Hadjouis, président de commission UISPP « Méthodes et théorie archéologiques »
9h30-10h : Henry de Lumley, Professeur et Directeur du Muséum national d'Histoire naturelle : l’envol de toutes les sciences de l'évolution humaine
Anna Echassoux1et Salah Abdessadok2 : 1. Directrice générale, Institut de Paléontologie Humaine, 2. Ingénieur de recherche, MNHN.
10h-10h30 : Jean-Baptiste de Monet, chevalier de La Marck, dit Lamarck, un esprit de physicien du vivant aux fondements de la théorie de l’évolution des espèces
Anne Dambricourt Malassé, CNRS, MNHN, UPVD
10h30-11h : Débat et pause café
11h-11h30 : Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, auteur d'une méthodologie incontournable pour les Sciences du vivant.
Philippe Petit, Enseignant d’anatomie auprès des Hôpitaux de Paris (anatomie, ostéopathie)
11h30-12h : Alcide d’Orbigny dans l’histoire de la stratigraphie
Marc Godinot, EPHE Paris
12h-12h30 : Quatrefages et Hamy, fondateurs de l’anthropologie moderne
Alain Froment, Musée de l’Homme
12h30-12h45 : débat
12h45-14h : déjeuner. Les conférenciers sont invités à la brasserie Le Saint-Marcel
14h-14h30 : Albert Gaudry et Edouard Lartet à Saint-Acheul (1859-1860) : la preuve de l'ancienneté de l'Homme et la naissance de la Préhistoire
François Djindjian, UMR 7041 Arscan
14h30-15h : Marcellin Boule et Camille Arambourg : le MNHN, de la Géologie à la Préhistoire
Djillali Hadjouis, président de commission UISPP « Méthodes et théorie archéologiques »
15h-15h30 : Théodore Monod : Le long voyage à travers les dunes du Sahara central
Iddir Amara, Pr de Préhistoire, Université Alger 2
15h30-16h : Roger Saban, anatomiste visionnaire impliqué dans des processus thérapeutiques.
Philippe Petit, Enseignant d’anatomie auprès des Hôpitaux de Paris (anatomie, ostéopathie)
16h-16h15 : débat et clôture du colloque

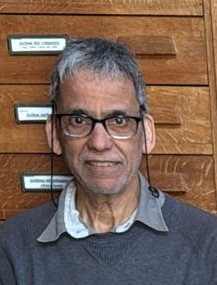
Henry de Lumley, Professeur et Directeur du Muséum national d'Histoire naturelle : l’envol de toutes les sciences de l'évolution humaine.
Anna Echassoux et Salah Abdessadok
Entré au CNRS à l'âge de 21 ans, Henry de Lumley, géologue et préhistorien, a développé la recherche en préhistoire dans toutes ses dimensions, au long de 7 décennies durant lesquelles il a supervisé de nombreux chantiers de fouilles en France et à l’étranger, créé des musées sur les sites archéologiques et formé des centaines d’étudiants de plus de 50 nationalités. Pionnier d’une recherche intégratrice, basée sur une archéologie de terrain et une approche naturaliste, il a mis en œuvre l'exhaustivité, la pluridisciplinarité et la recherche sur le très long terme. En misant, dès le début, sur des méthodes universelles, tout en constituant d'importantes bases de données, il a propulsé les études sur l'origine de l’Homme, son développement morphologique et culturel, ses paléoenvironnements et le cadrage géochronologique. Avec la même audace et la même créativité que ses prédécesseurs à l'Institut de Paléontologie Humaine, fondation Albert Ier de Monaco, Henry de Lumley a fortifié une école de la préhistoire qui s'est exportée dans le monde entier.
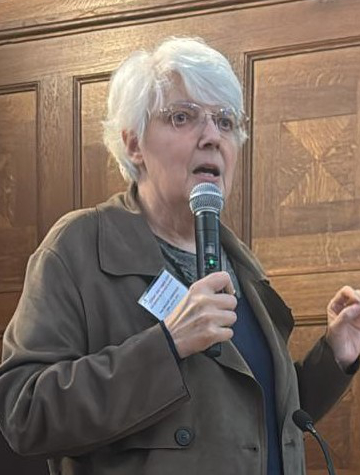
Jean-Baptiste de Monet, chevalier de La Marck, dit Lamarck, un esprit de physicien du vivant aux fondements de la théorie de l’évolution des espèces.
Anne Dambricourt Malassé
Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) était une référence pour Charles Darwin (1809-1882) qui ne manqua pas de le rappeler lorsque celui-ci aborda les origines simiennes de l’Homme en 1871. Il fit également sienne sa théorie de la transmission héréditaire des changements acquis au cours de la vie des organismes, une condition incontournable pour soutenir la succession graduelle des formes anatomiques disparues. Lamarck avait un esprit de physicien déjà manifesté dans un essai qu’il avait confié en 1744 à Georges Buffon pour le soumettre à l’Académie des sciences mais sans succès : Recherches sur les causes des principaux faits physiques. Il publia un second essai en 1797 : Mémoires de physique et d'histoire naturelle, établis sur des bases de raisonnement indépendantes de toute théorie. Et cinq années plus tard, il produisait le texte fondateur de la théorie de la transformation des espèces : Recherches sur l'organisation des corps vivans, et particulièrement sur son origine, sur la cause de son développement et des progrès de sa composition. La comparaison de ses écrits montre que sa démarche fut aux prémices de la théorie de l’auto-organisation du vivant.
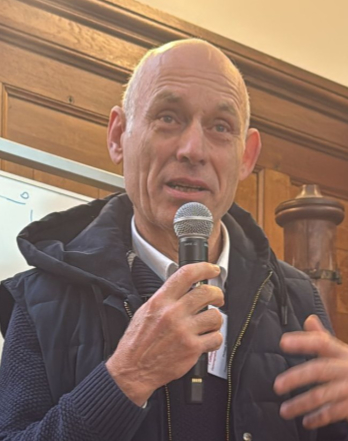
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, auteur d'une méthodologie incontournable pour les Sciences du vivant.
Philippe Petit
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire 1772 –1844 est l'homme d’une idée, à savoir « l’Unité de Composition du vivant ». Cette idée au sein de son ouvrage Philosophie anatomique se trouve confirmée aujourd’hui en biologie moléculaire. Ainsi, son idée sert de fil conducteur dans les découvertes actuelles. Elles montrent la continuité du vivant inscrite à l’intérieur d’un filament d’ADN (gènes homéotiques drosophile ou homeobox). En l’absence de la génétique, découverte un siècle plus tard, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire relie l’embryologie et la tératologie pour illustrer une "Unité de composition" dans une anatomie comparée.

Alcide d’Orbigny dans l’histoire de la stratigraphie.
Marc Godinot
Alcide d’Orbigny effectue un long voyage en Amérique, de 1826 à 1834, pour le compte du Muséum. Il en rapporte une moisson de collections et d’observations qu’il utilisera plus tard. Pendant ces années d’absence, la stratigraphie basée sur la paléontologie se met en place, en particulier en 1829-1830 (Brongniart, Deshayes, Lyell). A son retour, il se passionne pour la paléontologie. Alors que ses prédécesseurs ont surtout travaillé sur le Tertiaire, lui va parcourir la France et accumuler une énorme collection d’invertébrés marins récoltés dans des terrains secondaires, essentiellement jurassiques et crétacés. Il accorde une attention toute spéciale aux strates d’où ils proviennent. Frappé par les ressemblances paléontologiques entre des faunes françaises et des faunes qu’il a vues en Amérique du Sud, il propose des étages marins à valeur universelle, identifiables sur tous les continents par leur contenu en fossiles. Pour que ses étages marins soient bien définis, il faut qu’ils soient séparés par des coupures nettes, et universelles. Il a été impressionné par les reliefs géants de la Cordillère des Andes, que l’on imagine alors résultant de catastrophes gigantesques (dans la ligne des révolutions du globe de Cuvier). Il interprète les coupures entre ses étages comme résultant de catastrophes, qu’il généralise et dogmatise. Ces catastrophes sont suivies de (re)créations, qui lui vaudront beaucoup d’incompréhensions. Certains auteurs qualifient son cadre stratigraphique de théiste ! Doit-on le soupçonner de masquer un créationnisme surnaturel derrière ses renouvellements de faunes ? Ou bien, sachant l’usage de création naturelle courant au XIXe, ne doit-on pas plutôt le considérer comme un vrai« philosophe de la nature » de son époque, débarrassé de préjugés religieux dans sa science? Quelle que soit la réponse à cette question, il reste un contributeur majeur de l’histoire de la stratigraphie, par l’utilisation du concept d’étage, et la définition d’une vingtaine d’étages toujours utilisés par les géologues.

Quatrefages et Hamy, fondateurs de l’anthropologie moderne.
Alain Froment
Le Muséum a joué un rôle crucial dans le développement des sciences de l’Homme au milieu du 19è siècle. Au moment où Darwin publie son ouvrage fondamental et où Broca fonde la Société d’Anthropologie, Armand de Quatrefages a déjà ouvert la galerie d’anthropologie du Jardin des Plantes, et renommé la chaire d’histoire naturelle de l’Homme en chaire d’anthropologie, y intégrant de surcroît l’ethnographie. Son successeur Ernest Hamy accorde tant d’importance aux cultures matérielles qu’il leur dédie un musée spécifique au Trocadéro, qui deviendra le Musée de l’Homme. Bien avant l’école américaine de Boas, ces deux scientifiques progressistes font ainsi entrer l’anthropologie dans la modernité.

Albert Gaudry et Edouard Lartet à Saint-Acheul (1859-1860) : la preuve de l'ancienneté de l'Homme et la naissance de la Préhistoire.
François Djindjian
En Science, il n’y a pas de démonstration sans preuves indiscutables. L’opinion ne compte pas. Ce sont les difficultés qu’ont rencontrées dans la première moitié du XIXème siècle, plusieurs pionniers de la préhistoire, comme John Frere (1740-1807), François de Jouannet (1765-1845), Philippe-Charles Schmerling (1790-1836), Jules de Christol (1802-1861), Casimir Picard (1805-1841), Paul Tournal (1805-1872), dont beaucoup se sont heurtés en France à Georges Cuvier (1769-1832) puis à ses élèves Pierre Flourens (1794-1867) et Elie de Beaumont (1798-1874). La preuve sera apportée par Albert Gaudry (1827-1908), alors jeune attaché au Muséum National d’Histoire Naturelle, grâce à ses fouilles de contrôle sur le site de Saint-Acheul en 1859 pour vérifier la publication le 26 mai 1859 de l’anglais Prestwich dans les Proceedings de la Royal Society. Sa note sera lue à la séance de l’Académie des Sciences du 3 octobre 1859. A l’invitation d’Albert Gaudry, Edouard Lartet (1801-1871) viendra relever une coupe stratigraphique en 1860. La deuxième preuve sera apportée par la découverte dans le grand abri de la Madeleine par Edouard Lartet d’un mammouth gravé sur un fragment d’ivoire de défense de mammouth en 1864, confirmant la contemporanéité de l’homme avec des espèces disparues. Albert Gaudry obtiendra finalement en 1872, la chaire de paléontologie du Muséum d’Histoire naturelle, créée pour Alcide d’Orbigny en 1853 (malgré l’opposition des professeurs du Muséum qui cherchèrent à la supprimer pendant vingt ans), et succédant à Edouard Lartet qui l’avait obtenu en 1869. Albert Gaudry, comme la remarquablement écrit Pascal Tassy dans le livre qu‘il lui a consacré, a été le moteur de l’évolutionnisme au Muséum National d’Histoire Naturelle. En 1863, Elie de Baumont interviendra dans la séance du 18 mai de l’Académie des Sciences en déclarant :« Je ne crois pas que l’espèce humaine ait été contemporaine de l’Elephas primigenius. Je continue à partager à cet égard l’opinion de M. Cuvier. L’opinion de Cuvier est une création du génie ; elle n’est pas détruite ». En 1863, il ne s’agissait plus de preuves dans le camp des disciples de Cuvier, mais d’opinion.

Marcellin Boule et Camille Arambourg : le MNHN, de la Géologie à la Préhistoire.
Djillali Hadjouis
Entre la seconde moitié du XIXème siècle et la première moitié du XXème, quatre naturalistes français se sont succédé à la chaire de paléontologie du Muséum National d’Histoire naturelle de Paris, ayant en commun, un parcours scientifique et idéologique presque semblable, des géologues et paléontologues s’intéressant à la préhistoire et à l’homme fossile. Edouard Lartet, paléontologue autodidacte et découvreur du célèbre gisement paléontologique de Sanson dans le Gers, ainsi que des sites préhistoriques majeurs dans le Périgord (Le Moustier, Laugerie Basse, La Madeleine), Albert Gaudry, successeur d’Alcide d’Orbigny à la chaire de paléontologie du Muséum (1872), président de l’académie des Sciences et découvreur des sites fossilifères miocènes de Pikermi en Grèce et les premières fouilles de la carrière Saint-Acheul dont il donna le nom acheuléen. S’ensuivit une figure incontournable de la stratigraphie et des gisements fossilifères du Velay (Auvergne), de la paléontologie des vertébrés de France et d’Outre-mer et de la paléoanthropologie, Marcellin Boule, disciple d’Albert Gaudry dont il prendra les rênes de l’Institut de paléontologie du Muséum dès 1900 et directeur de l’Institut de Paléontologie Humaine dès 1910 avec l’Abbé Henri Breuil. Il appuiera le géologue et paléontologue Camille Arambourg, grand spécialiste des faunes de vertébrés d’Afrique du Nord et bien d’autres contrées, à lui succéder à la chaire de paléontologie en 1936. Dans cette présentation, nous nous intéresserons surtout aux recherches paléoanthropologiques et préhistoriques des deux derniers naturalistes : Marcellin Boule et l’analyse anatomo-posturale du squelette de La Chapelle-Aux-Saints et les sites préhistoriques d’intérêt que fouilla Camille Arambourg en insistant sur les caractères biochronologique, biogéographique et paléoenvironnementaux.
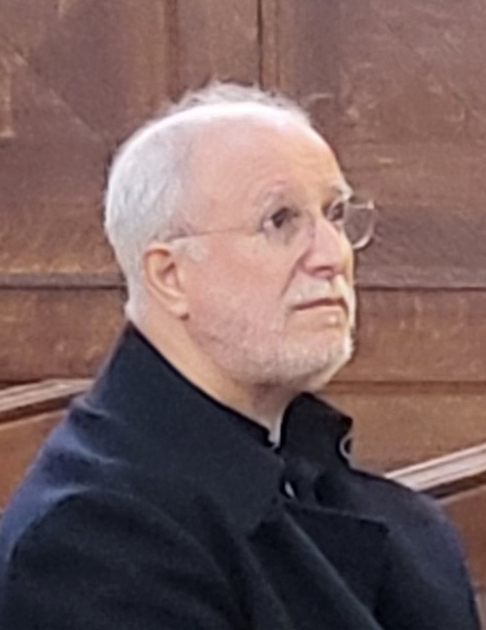
Théodore Monod : Le long voyage à travers les dunes du Sahara central.
Iddir Amara
Grand marcheur, Théodore Monod (1902-2000) a traversé le Sahara à pied comme un nomade accompagné de ses dromadaires, pour porter nourritures et matériels scientifiques, lors de ces longues expéditions. Dès 1922, il découvre le Sahara. Jeune naturaliste et explorateur, il part à la découverte de ce vaste territoire aride. Il a réussi la grande traversée de 900 km allant de Ouadan à Araouan. La partie sud-ouest du Sahara qui n'était pas encore connue des explorateurs et du monde scientifique du XIXème siècle. Il avait commencé sa carrière comme océanographe au Muséum, au département des Pêches et Production coloniale. Pour cela, il s’est installé sur les côtes africaines de la Mauritanie ou sa carrière scientifique commence. Lors de ses longs périples dans le Sahara central, il découvre d’importants sites préhistoriques d'Asselar, d'Adrar-Ahnet qu’il avait publiés. En 1938, il est nommé directeur de l’IFAN à Dakar dont il est le fondateur. A partir de cette date le nom de Théodore Monod rejoint la liste des grands explorateurs qui nous ont fait découvrir le Sahara. Il serait le dernier grand savant et explorateur du Sahara du XXème siècle.
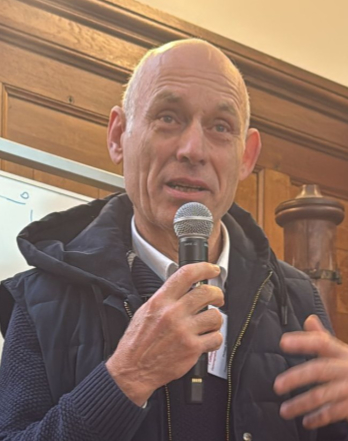
Roger Saban, anatomiste visionnaire impliqué dans des processus thérapeutiques.
Philippe Petit
Roger Saban (1920-2011), après des études avec Jean Piveteau, a consacré cinquante années à la paléontologie et à l’anatomie comparée entre espèces. Un de ses centres de recherche fut la vascularisation méningée grâce à des moulages endocrâniens pour expliquer l’apparition du langage entre autres. Auteur de plus de deux cents publications scientifiques, ce neuro-paléontologue rédigea dans le “Traité de Zoologie” tous les articles consacrés aux structures méningées. Dans son ouvrage “Aux sources du langage articulé” aux éditions Masson, Roger Saban s’inscrit dans une pluridisciplinarité évidente pour éclairer une phylogénie du processus linguistique en mettant en corrélation des images mentales et la linguistique.